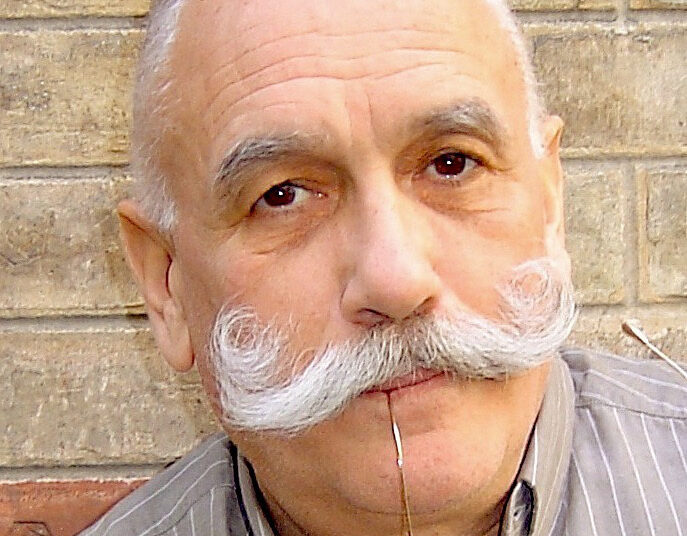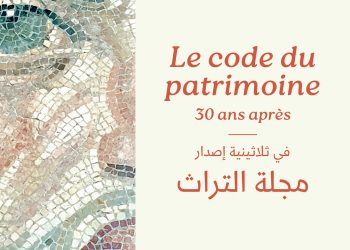L’urbanisation a désormais gagné la totalité des territoires de l’œcoumène. Le développement massif et accéléré du redéploiement des activités et des divers groupes sociaux dans des agglomérations aux dimensions inconnues jusqu’à présent se solde par une profonde modification de l’image de la ville. C’est aussi la raison, pour laquelle malgré l’apparition de l’urbanisme au tournant du XXe siècle, aucune discipline ne saurait rendre compte à elle seule de ce qui se passe et il nous faut recourir à des approches résolument interdisciplinaires des territoires urbanisés et des multiples images qu’ils nous offrent désormais. C’est la valeur symbolique des lieux qui offrait jadis une image de la ville, qu’elle soit mentale ou matérialisée dans une icône, suffisamment simple et synthétique pour que tout le monde puisse aisément s’y retrouver. Ce n’est plus le cas à l’heure actuelle. Le mercantilisme s’insinuant dans tous les pores de la société, la désacralisation des lieux publics, la profanation des lieux symboliques et les perversions de la monumentalité brouillent l’image des relations entre les sociétés et leurs espaces.
On peut se poser la question de savoir comment le tiraillement entre des centres anciens en cours de revitalisation au risque d’être muséifiés, des périphéries en attente de meilleures dessertes par les transports en commun économes en énergie et d’une centralité périurbaine utile au quotidien, et la nature réinventée des équipements touristiques (plages sur un littoral, par ailleurs menacé par la montée des eaux, îles « désertes », forêts « vierges », montagnes escaladées ou dévalées, randonnées pédestres) vont redessiner l’image des agglomérations actuelles sans les dénaturer et faire advenir une structure urbaine démocratique parce que répondant aux attentes du plus grand nombre et échappant aux ségrégations les plus criantes.
Support authors and subscribe to content
This is premium stuff. Subscribe to read the entire article.