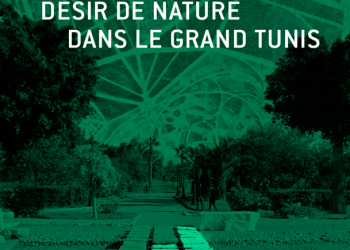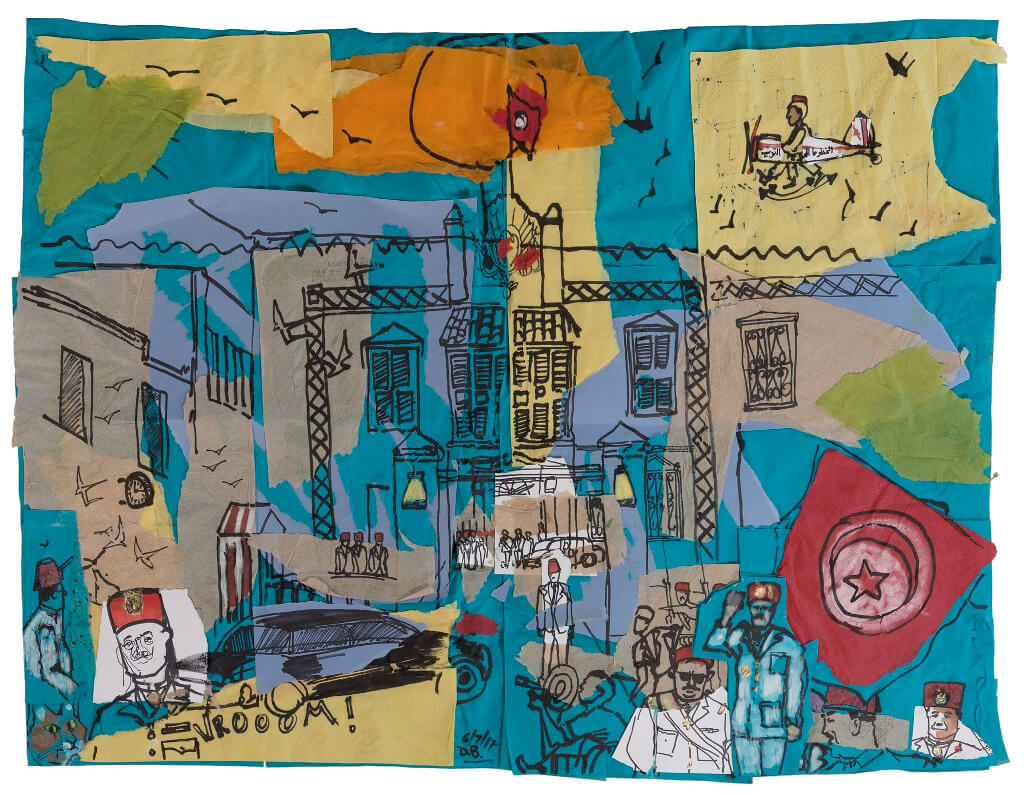Les communes tunisiennes s’apprêtent en 2014 à élaborer leurs Programmes d’Investissement Communaux (PIC). Ces programmes s’étalent sur cinq années et correspondent aux investissements que chaque commune projette de réaliser que ce soit d’une manière autonome, ou en ayant recours à d’autres intervenants, essentiellement les départements ministériels chargés des équipements et services (Culture, Jeunesse et Sport essentiellement).
Par le passé, l’encadrement des communes et l’arbitrage étaient assurés par d’autres départements centraux de tutelle. Le volume total de l’investissement communal n’a pas progressé considérablement depuis deux décennies (et a même diminué si on considère les prix fixes de 1990), réduisant ainsi le rôle des communes en matière de développement et renforçant la centralisation du système politique et économique. A partir des années 2000, beaucoup de communes sont devenues incapables d’assurer l’autofinancement nécessaire pour la réalisation du PIC, ce qui a conduit à la diminution du taux de réalisation des projets.
L’approche sectorielle reste dominante dans la définition des investissements communaux. Préparés généralement par les services internes de la commune, souvent dans la précipitation, et déconnectés des documents de planification urbaine, ces PIC n’arrivent pas à représenter des visions cohérentes pour des interventions spatiales sur la ville, susceptibles d’améliorer considérablement le cadre de vie des habitants, dans l’ensemble des quartiers. La faiblesse des montants des PIC également (près de 27 DT par personne et par année entre 2007 et 2011) constitue un frein pour faire de ces programmes des leviers pour le développement des villes.
L’engagement des communes aujourd’hui, trois ans après la révolution, dans la préparation de nouveaux PIC pour la période 2014 – 2018 soulève un ensemble d’enjeux. Tout d’abord, la période actuelle se caractérise par une faiblesse des institutions locales, héritée des dysfonctionnements structurels du passé mais également aggravée par une crise de légitimité des délégations spéciales et par la faiblesse des moyens de contrôle et de maîtrise de l’espace urbain depuis 2011. Cette situation, qui a conduit à ralentir sensiblement le rythme de réalisation des projets communaux, soulève la question de la capacité réelle des communes aujourd’hui à entreprendre des réflexions sérieuses sur l’avenir de leurs espaces urbains et à concrétiser par la suite les projets identifiés. Dans ce cadre, un effort important doit être consenti afin d’appuyer les communes – notamment les moyennes et petites d’entre elles – dans les phases de conception de leurs PIC et dans la conduite des projets qui en découleront. Cet appui ne devrait pas se limiter uniquement aux services publics centraux et régionaux mais doit être élargi aux instances et partenaires bilatéraux et internationaux d’appui au développement ainsi qu’aux organisations de la société civile.
Une autre question s’impose : les PIC peuvent-ils améliorer sensiblement le cadre de vie dans nos villes ? La réponse ne peut être que mitigée. Au regard du montant total de l’investissement communal (on évoque le chiffre de 1200 millions de dinars tunisiens, pour les 264 communes, sur cinq années), il apparaît que cette enveloppe est incapable de résoudre fondamentalement les problèmes majeurs actuels des villes. Néanmoins, une optimisation de cette ressource et l’engagement de projets en partenariat (entre communes, avec le secteur privé et les organisations de la société civile) sont susceptibles de donner plus d’efficience aux projets du PIC, et de toucher plus profondément et d’une manière plus généralisée les besoins des citoyens.
La question de la participation citoyenne aux processus d’identification des projets – et par la suite de l’évaluation des réalisations – représente aussi un enjeu majeur. La constitution du 26 Janvier vient d’inscrire la participation citoyenne dans les affaires de la Cité. La préparation du PIC est ainsi un premier exercice pratique qui est appelé à démontrer le bien fondé de cette orientation. Là également, la faiblesse des moyens humains et matériels des communes appelle à consolider les efforts de soutien aux collectivités dans la phase d’implication des citoyens dans la préparation des PIC qui nécessite à la fois un savoir faire et des moyens adéquats.
L’ensemble des constats et enjeux soulevés et des questions suscitées par le chantier du nouveau PIC fait que ce projet ne soit pas perçu et appréhendé comme un acte administratif de budgétisation des projets communaux mais comme une action collective associant toutes les forces locales autour de visions partagées sur l’avenir des villes, tout en restant conscients que les PIC ne peuvent être que des débuts – et certainement incomplets – de concrétisation de ces visions. Le degré de réussite de cette expérience déterminera sans doute le rythme de mise en œuvre des prochaines réformes territoriales.
Par Sami Yassine Turki, Président de l’Association Tunisienne des Urbanistes
Article paru dans Archibat n°31 – Mai 2014