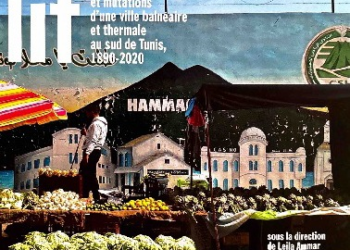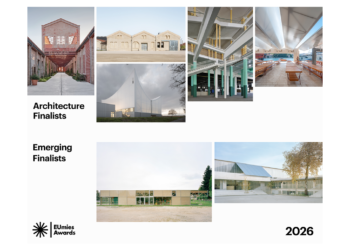Début 2024, s’est tenue la 3e conférence générale de la Stratégie de Développement de la Ville de Tunis (SDVT). Ce rendez-vous marquant est venu clore un cycle de planification stratégique de plus de trois ans, amorcé avec l’ambition de réinscrire Tunis dans une trajectoire de développement durable, résiliente et inclusive. Après avoir partagé un diagnostic approfondi du territoire et défini un cadre stratégique consensuel – exposés lors des conférences précédentes –, la commune de Tunis a présenté cette fois-ci le cœur opérationnel de la stratégie : un plan d’action structurant, composé de projets à fort impact, prêts à transformer les ambitions en réalités urbaines.
Un processus façonné par les turbulences du contexte national
Le processus d’élaboration de la SDVT s’est inscrit dans un contexte national contraignant. Il a été modelé par une série de faits institutionnels, économiques, sociaux et sanitaires qui ont à la fois compliqué son déploiement, mais aussi souligné l’urgence d’un cadre stratégique partagé pour le développement de la capitale.
Sur le plan institutionnel, la SDVT s’est déroulée en parallèle d’une transition politique marquée par la suspension des conseils municipaux en 2023, interrompant l’élan donné par les élections locales de 2018 et la promulgation du Code des collectivités locales qui constitua, au démarrage du processus, le socle juridique de la démarche. Le flou institutionnel qui a marqué la période de transition a pesé sur la légitimité du pilotage local et a complexifié la mobilisation des directions municipales, parfois désorientées quant à leurs prérogatives. À cela, s’est ajouté un flou sur le devenir des agences d’aménagement telles que l’AUGT, en discussion pour une transformation en agence métropolitaine, rendant hypothétique l’architecture future de la gouvernance territoriale du Grand Tunis.
Sur le plan économique, la stratégie a été élaborée dans un contexte de crise aggravée par les effets de la pandémie de COVID-19 qui ont considérablement réduit la capacité d’investissement public. Dans ce cadre, la SDVT a dû imaginer des montages innovants pour rendre réalisables ses ambitions.
Sur le plan social, la fragmentation urbaine s’est accentuée. Les inégalités entre les quartiers se sont creusées et les attentes citoyennes en matière de services, d’environnement et de participation n’ont cessé de croître.
Enfin, la pandémie de COVID-19 a marqué un temps fort dans la chronologie du projet. Le confinement, les restrictions sanitaires et l’interdiction des rassemblements publics ont considérablement perturbé les premières phases du processus. Les ateliers participatifs ont dû être repensés, certains moments de concertation ont été suspendus ou digitalisés, et les réunions en présentiel ont longtemps été impossibles. Cette contrainte a renforcé la nécessité d’une communication multicanal (vidéos pédagogiques, réseaux sociaux, stands mobiles), mais a aussi laissé en suspens certains dialogues inter-acteurs, notamment au niveau de la gouvernance métropolitaine.
En dépit de ces aléas, la SDVT a pu maintenir le cap grâce à une ingénierie de projet agile, une implication soutenue des partenaires institutionnels publics et une volonté affirmée des acteurs de faire de cette stratégie un levier de développement concret. Elle apparaît aujourd’hui comme un outil pour tenir le cap face à un environnement incertain, et comme une démonstration que, même dans les périodes les plus délicates, une planification concertée reste possible et porteuse d’espoir.
Une démarche rigoureuse et une expertise collective mobilisée
Avant d’en arriver à cette étape décisive, la mise au point de la stratégie a suivi une méthodologie rigoureuse, adaptée aux spécificités du contexte tunisien et enrichie par l’expérience des projets antérieurs comme Madinatouna. Le processus s’est structuré autour de cinq étapes : pré-diagnostic, diagnostic territorial, élaboration du cadre stratégique, plan d’action, et conception du dispositif de mise en œuvre. À chaque étape, une forte composante participative a été activée à travers des ateliers, des enquêtes publiques, des entretiens et des conférences ouvertes.
Un autre pilier fondamental du processus SDVT a été l’implication active des cadres et directeurs techniques de la commune à travers un comité de suivi technique dédié. Ce comité, constitué des responsables des différents services municipaux (urbanisme, environnement, propreté, équipements, services sociaux, etc.), a joué un rôle clé dans l’animation du processus, la validation technique des livrables à chaque étape, et la coordination avec l’équipe d’experts.
Il a permis d’assurer l’ancrage institutionnel de la démarche au sein même de l’administration municipale et de préparer les conditions concrètes de sa mise en œuvre.
L’appui d’une équipe pluridisciplinaire d’experts sectoriels a également été déterminant. Urbanistes, économistes, environnementalistes, spécialistes de la gouvernance locale, de l’inclusion sociale ou du marketing territorial ont contribué à structurer les débats, enrichir les diagnostics et traduire les ambitions territoriales en projets concrets. Leur regard croisé a permis de dépasser les cloisonnements administratifs et de porter une lecture systémique des enjeux de la ville.
Une vision partagée, traduite en plan d’action structurant
Aboutissement de ce processus, le plan d’action présenté lors de la 3e conférence s’organise autour de six chantiers stratégiques, regroupant une cinquantaine de projets à forts enjeux territoriaux, économiques, sociaux et environnementaux. Chacun de ces chantiers constitue une porte d’entrée vers une transformation urbaine ambitieuse et pragmatique. Sans viser l’exhaustivité, nous présentons ici un échantillon de projets par chantier stratégique pour illustrer les ambitions de la stratégie :
1. Attractivité, rayonnement et innovation économique
Tunis Innovation Hub : plateforme dédiée à l’incubation de projets urbains innovants et à la mise en réseau des acteurs du territoire.
Branding métropolitain : stratégie d’image, de communication et de narration pour repositionner Tunis sur la scène nationale et internationale.
Nouvelle génération de marchés communaux : pôles économiques de quartier intégrant services, culture, artisanat et développement durable.
(…)
Par Walid Maarouf Bel Haj Ali, Architecte – Urbaniste
Photos : Artus productions
Pour lire le reste de l’article paru dans Archibat n°65 – Octobre 2025, vous pouvez le commander ou vous abonner en ligne : https://archibat.info/shop/