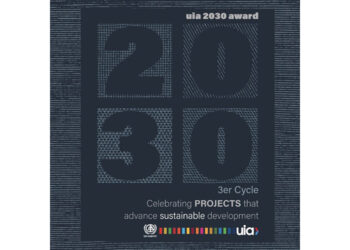*Cet article est le fruit d’un projet de recherche ayant bénéficié d’un financement de la part d’Al- Mujadilah Center for Women, Qatar Foundation sous le titre “Women in the urban fabric : The case of the Kingdom of Tunis” et le numéro de projet 24-2025-8-04
La présence des femmes dans la sphère publique tunisienne reste un sujet peu étudié. Les récentes publications de l’historienne Leila Temim Blili sur les femmes de la Cour husseinite1 ont permis de jeter un regard nouveau sur un genre délaissé par les chercheurs et de raviver le feu prométhéen allumé par Hassan Hosni Abdelwahab dans son Shahîrat al Tûnusiyât2. S’intéressant à la vie de Cour et aux alliances familiales, elles appellent à une contribution plus développée sur la participation à la vie économique, culturelle et sociale et, en puisant dans les sources les plus anciennes et en privilégiant la Longue durée, à questionner leur rôle de bâtisseur et l’impact de leurs réalisations sur la physionomie de la ville et son fonctionnement.
Les sœurs charitables. Fâtima & Maryam al Fihrî et la genèse de la ville de Fès
Au IXème siècle les sœurs kairouannaises Fâtima et Maryam, filles de Muhammad al Fihrî al Qurayshî, entrent dans l’histoire comme fondatrices de monuments à l’importance capitale dans la ville idrisside de Fès. Si Maryam fonde la mosquée des Andalous (Jâma’ al Andalusiyyîn), Fâtima (800-880) s’illustre en finançant la construction de la Grande Mosquée de Fès (Jâma’ al Qarawiyyîn), destinée à en devenir l’université, la plus ancienne au monde encore en fonctionnement de nos jours3.
Ces actes de charité et de dévotion, accomplis par deux femmes de l’époque aghlabide connues pour leur éducation soignée et leur piété, ont marqué les esprits et façonné en profondeur l’architecture et l’urbanisme de la ville de Fès et nous devons en particulier à l’historien Abū al-Hassan ‘Alî ibn Abî Zar‘ al-Fâsî (m. 1326) d’en avoir restitué l’histoire dans son opus Kitâb al-anîs al-muṭrib bi-rawḍ al-qirṭâs fî akhbâr mulûk al-maghrab wa târîkh madînat Fâs, généralement cité par le titre abrégé Rawdh al Qirtâs4, rédigé au XIVème siècle sous le règne du sultan mérinide Abû Sa’îd ‘Uthmân II (1276-1331).
Cet épisode historique édifiant nous invite à poursuivre la trace de contributions féminines à la formation et à l’évolution des villes d’Afrique du Nord et notamment de Tunis.
Jâma’ al Tawfîq (al Hawâ), premier complexe religieux de la capitale ifrikienne
La ville de Tunis doit à la princesse ‘Atf, épouse du premier sultan hafside Abû Zakariyyâ Ier, et mère du futur sultan Abû `Abd Allah Muhammad al-Mustansir, la construction, en 1252, d’un complexe religieux structuré essentiellement autour d’une mosquée à prêche et d’une médersa assurant l’enseignement du rite sunnite malékite. L’ensemble forme l’un des joyaux de l’architecture tunisienne et a accueilli des savants illustres, financées grâce au système de waqfs mis en place par la princesse, dont Muhammad ibn ‘Abd al Salâm ibn Yûsuf al-Huwwârî, enseignant qui joua un rôle majeur dans la formation d’ibn Khuldûn.
Du complexe religieux édifié par la princesse d’origine européenne et chrétienne ‘Atf, épouse d’Abû Zakariyyâ Ier, il ne reste aujourd’hui que la mosquée à prêche. La madrasa, qui lui faisait autrefois face, a été détruite et un autre édifice dépourvu d’intérêt lui a succédé sous le même nom à l’ouest du minaret. Il en va de même pour le kuttâb et l’hammâm, tous deux disparus.
La mosquée a quant à elle été bien préservée dans son ensemble et nous devons à Abdelaziz Daouletli une étude détaillée de son architecture singulière. Le complexe religieux de Jâma’ al Tawfîq est en effet novateur à plus d’un titre. Deuxième mosquée à prêche de la ville, elle est la première que nous puissions attribuer avec certitude à un commanditaire féminin et le premier complexe religieux, comportant de nombreux équipements, créé d’un seul tenant. Contrairement à la Grande Mosquée Zaytûna, la salle de prière n’est pas précédée de cour, mais présente la particularité d’être enveloppée dans un enclos dégageant un espace découvert sauf au niveau du mur du mihrâb.
Ce dernier est l’unique mur à ne pas être pourvu de contreforts présentant une grande variété de largeurs et de positions ; nombre d’entre eux ne s’inscrivent d’ailleurs pas dans l’alignement des colonnes supportant les travées. Cette particularité est partagée avec un édifice hafside postérieur, le Jâma’ al Zitûna al Barrâni ou Jâma’ al Zarar’iyya, située à l’extérieur de la ville, à proximité de Bâb al Bahr et construit en 1283. L’aspect de robustesse que procure ce dispositif au monument renvoie probablement à sa fonction défensive ou de refuge. En effet, situé à quelques mètres de Bâb Khâlid, le complexe était exposé aux assauts et complétait vraisemblablement le dispositif défensif de Musallâ al ‘Îdayn (oratoire à ciel ouvert des deux célébrations), pourvu de tours et de créneaux. Sa fonction religieuse primait néanmoins sur sa fonction militaire et les choix constructifs semblent avoir été dictés par un impératif de robustesse plus que par des visées défensives. La salle de prière est composée de sept nefs et six travées couvertes de voûtes d’arêtes reposant sur des arcs doubleaux. Seule la présence d’une coupole au-dessus du mihrâb et sa centralité distinguent la nef principale des autres. Souvent d’origine antique, les chapiteaux ajoutent à la variété de la composition d’un ensemble architectural dont les matériaux, les galbes et les proportions différent d’une colonne à l’autre. Si le mihrâb est plus dépouillé que celui de la moquée de la Qasaba, il présente néanmoins un élément qui fait là son apparition, le motif serpentiforme rapporté en bas des pieddroits. Le minaret actuel, élevé sur un plan carré à étage unique et surmonté d’un lanternon, n’a conservé en revanche que sa base. Les deux-tiers supérieurs sont postérieurs à la période hafside mais l’esprit qui a présidé à la conception des minarets hafsides notamment celui de la mosquée de la Qasaba, est bien là. En témoigne aussi l’aménagement des escaliers contournant un noyau creux pourvu de deux salles5. L’ensemble, salle de prières et minaret a fait l’objet d’une restauration importante sous les ordres du saint andalou Abû al Ghayth al Qashshâsh6 au XVIIème siècle ce dont témoignent les nombreux chapiteaux ottomans ayant remplacés les chapiteaux antiques originels.
‘Azîza ‘Uthmâna, sainte parmi les princesses de Tunis
Si, par son ampleur, sa beauté, la typologie développée et la diversité des institutions qu’il abritait, le complexe religieux al Tawfîq est unique en son genre, les contributions féminines à la fabrique urbaine de Tunis n’ont cependant pas disparu. Loin de là. Le XVIIème siècle voit ainsi l’esprit de charité et de piété animer une dame de la noblesse ottomane de Tunis dont le souvenir est toujours vif de nos jours.
Il s’agit de la princesse ‘Aziza ‘Uthmâna. Autre figure dont le nom nous soit parvenu, mais dont on mesure insuffisamment la contribution à l’évolution de la ville de Tunis, elle a, à la fin de sa vie affranchit ses esclaves et constitué en hâbûs la totalité des biens dont elle pouvait disposer à sa guise, soit plus de 90 000 hectares de terrains plantés ou semés, au profit d’œuvres caritatives très diverses dont hôpital (bimuristân en arabe) de la rue El Azzafine, projet de son époux, Hammûda qui fit restaurer en 1662 l’ancien bimuristân fondée deux siècles plus tôt par un prince hafside et lui adjoint un terrain attenant sur lequel était édifié un fondouk (terme renvoyant à une auberge souvent à connotation corporative, nationale, régionale ou religieuse), et qui présentait la particularité de traiter les personnes souffrant de maladies mentales par la musique, un orchestre étant embauché à demeure à cet effet.
Réalisées successivement, les contributions de la princesse ‘Azîza ‘Uthmâna à la ville de Tunis, s’étaleront dans le temps et concerneront les différents territoires de la vieille ville. Il en va ainsi du Hammâm al Tammârîn, commanditée par la princesse afin d’équiper le Faubourg de Bâb al Jazîra, et plus précisément la rue al Hajjâmîn7 auquel adjoindra un Four à chaux (Kûsha al Jibs), un entrepôt, à Sûq al Sawâsî, à côté de Nâ’ûrat (moulin) Bîra ainsi qu’un débit de tabac (Hânût Dukhkhân) d’une boutique sise sûq al dukhkhân, situé près de Murkâdh8,
Le faubourg de Bâb Suwayqa ne sera pas en reste, la petite fille de ‘Uthmân Dey y fera édifier un four à pain (Kûsha al Khubz), sis rue du Foie9 ainsi que trois entrepôts dont les revenus seront répartis entre différentes œuvres pieuses. Sa dernière œuvre terrestre consistera en son propre mausolée, adossé à celui du grand saint Sîdî Ahmad ibn ‘Arûs pour lequel elle nourrissait une grande vénération et accessible depuis l’impasse de la madrasa al Shammâ’iyya.
En plus du financement d’œuvres d’utilité publique, Fâtima, fille de ‘Azîza ‘Uthmâna, a destiné un fonds particulier à l’entretien des oratoires et mosquées de la ville en mauvais état de conservation (litt. : en ruines) qui ne sont pas pourvues de dotations ou dont les dotations ne sont pas suffisantes à leur entretien. Ce fonds est destiné à couvrir les frais de maintenance, de réparation, de tapissage et d’éclairage10.
Toponymie et mémoire urbaine
L’étude de la toponymie fait apparaître bon nombre de personnalités féminines, souvent saintes dames ayant édifié leurs contemporains par leur dévotion et leurs œuvres charitables. Il en est ainsi de la Sayyida Masîka dont un oratoire portait le nom dans le quartier d’Al Halfawîn et dont il ne subsiste que le nom, donné à une rue voisine. Dans son ouvrage de références sur les lieux de culte de la Médina de Tunis au début du XXème siècle Muḥammad ibn al-Khûja mentionne que la sainte est réputée pour ses prodiges. On ne sait rien en revanche de la dame originaire de Bagdad qui a donné son à Masjid al-Baghdâdiyya, située rue al-Ḥaqîqa, dans le faubourg de Bâb al Jazîra. On peut ajouter à cette liste un oratoire à l’histoire récente ; le Masjid Banât al ‘Awâfî construit sur l’axe reliant Bâb al Suwayqa à Bâb Sa’dûn.
Conclusion
Si elles nous sont désormais connues sous formes d’anecdotes, ces contributions féminines à la fabrique urbaine de la Médina de Tunis, gagneraient à faire l’objet d’une recension se basant sur l’exploitation des travaux et ouvrages existants et traitant des édifices publics dont les mosquées, médersas, hôpitaux, mais aussi écoles coraniques (kuttâb), fontaines et autres édifices tant privés que d’utilité publique.
1 - Leila Temim Blili, Les femmes de la Maison houssaynîte – Al Harîm al Maçoun. Tunis: Script, 2022. 2 - Hasan Hosni Abdelwahab, Shahîrat al Tûnusiyât. Tunis : CREDIF, 2023 [1935]. 3 - Ruggero Vimercati Sanseverino, Fès et sainteté, de la fondation à l’avènement du Protectorat (808-1912) : Hagiographie, tradition spirituelle et héritage prophétique dans la ville de Mawlāy Idrīs, Rabat : Centre Jacques-Berque, 2014, p. 144. 4 - Ouvrage dont la première traduction française date du Second empire. Ali ibn 'Abd Allâh Ibn Abi Zar' al-Fasi et Beaumier, Roudh el-Karras : histoire des souverains du Maghreb [Espagne et Maroc] et annales de la ville de Fès, Paris : Imprimerie impériale, 1860. 5 - Abdelaziz Daouletli, Tunis sous les Hafsides. Evolution urbaine et activité architecturale. Tunis : INAAT, 1976, p. 204. 6 - Ahmed Saadaoui, Tunis au XVIIème siècle. Des actes de Waqf à l’époque des Deys et des Beys mouradites. 2011, p. 201-202. Le texte du waqf y est intégralement reproduit sous le n°332 sans toutefois mentionner les noms des donateurs. 7 - Bachrouch, Mawsû’at madînat Tûnis, Tunis: CERES, 1999, p. 328. 8 - Ahmed Saadaoui, op. cit., 2011, p. 142, 303 9 - Bachrouch, op. cit. 10 - Chibani Ben Belghith, Awqâf ‘Azîza ‘Uthmâna. Bayna Jam’iyyat al Awqâf wa ‘Urûsh al Mathâlîth fî ‘ahd al ihtilâl al firansî li Tûnis. Sfax: Maktabat ‘Alâ al Dîn, 2006, p. 25.
Par Adnen el Ghali, Architecte-urbaniste, docteur en histoire
Article paru dans Archibat n°64 – Juin 2025, vous pouvez le commander ou vous abonner en ligne : https://archibat.info/shop/