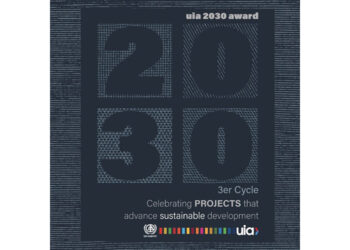La construction durable en Tunisie est à un tournant décisif. Entre ressources naturelles abondantes, savoir-faire ancestral et innovations technologiques, le pays possède tous les atouts pour évoluer vers un modèle plus écologique. Mais cette transition se heurte encore à des freins réglementaires, économiques et culturels. Dans cette interview, Lotfi Rejeb partage son analyse sur l’état actuel du secteur, l’impact des normes en vigueur et les initiatives à envisager pour promouvoir des pratiques plus durables. Entre enseignements du passé et innovations du futur, il dessine les contours d’une architecture responsable, ancrée dans son contexte et tournée vers l’avenir.
La construction durable en Tunisie est à un tournant décisif. Entre ressources naturelles abondantes, savoir-faire ancestral et innovations technologiques, le pays possède tous les atouts pour évoluer vers un modèle plus écologique. Mais cette transition se heurte encore à des freins réglementaires, économiques et culturels. Dans cette interview, Lotfi Rejeb partage son analyse sur l’état actuel du secteur, l’impact des normes en vigueur et les initiatives à envisager pour promouvoir des pratiques plus durables. Entre enseignements du passé et innovations du futur, il dessine les contours d’une architecture responsable, ancrée dans son contexte et tournée vers l’avenir.
Archibat | Comment évaluez-vous l’état actuel de la construction durable en Tunisie ? Quels sont, selon vous, les principaux obstacles et opportunités pour accélérer la transition vers des pratiques plus durables ?
L.R. | L’humain s’impose souvent une autocensure due à son ignorance ou au manque de maîtrise dès qu’il se trouve devant un sujet dans un domaine nouveau qui risque d’apporter des modifications significatives dans des réflexes quotidiens en matière de gestion des projets. C’est notamment le cas de l’administration et des différentes autorités responsables de la promotion du développement durable dans des pays comme le nôtre. Il existe de réelles opportunités pour accélérer la transition, l’État en est le premier responsable. La Tunisie dispose de ressources naturelles abondantes qui peuvent être exploitées de manière à offrir au pays une autonomie totale, comme les éléments climatologiques pour les énergies ou les matériaux locaux pour la construction. Cependant, adopter un concept ne suffit pas ; il faut également en maîtriser la mise en œuvre. L’anticipation, grâce à l’éducation civique, est la clé de cette transformation. Il est donc essentiel de développer des programmes de sensibilisation dès l’école primaire, puis de les étendre aux professionnels du secteur. Ces programmes doivent promouvoir des pratiques plus rationnelles dans la gestion des ressources, tout en tenant compte de notre culture locale, afin d’inculquer de nouveaux réflexes aux jeunes générations et de les préparer aux métiers d’avenir. Par ailleurs, pour encourager les investissements dans les technologies vertes, il est indispensable de renforcer les mécanismes économiques adaptés, tels que les partenariats public-privé (PPP). Il serait également pertinent de surmonter les réticences des promoteurs par le biais de subventions et d’avantages fiscaux incitatifs pour l’utilisation de ces concepts durables.
A. | Les réglementations et normes actuelles en matière de construction durable sont-elles suffisantes pour encourager un changement significatif dans le secteur ? Quelles améliorations ou initiatives supplémentaires recommanderiez-vous ?
L.R. | Ce n’est pas une question de quantité, mais de qualité. Il ne faut pas perdre de vue que nous vivons dans un pays où nous bénéficions, en moyenne, de dix mois de confort thermique naturel par an. Il suffit de raviver les savoirs ancestraux en matière de ventilation, d’orientation et de protection pour réduire l’impact des conditions climatiques extérieures sur nos intérieurs. À cela, il convient d’ajouter une approche scientifique, en adaptant nos comportements aux saisons et en tenant compte de la gestion hygrométrique, par exemple à travers la migration interne et l’utilisation de l’inertie thermique des matériaux dans l’aménagement des espaces. Cela permet d’obtenir des résultats significatifs en matière de confort et de durabilité. Il est essentiel d’éviter les normes qui privilégient l’utilisation de matériaux importés et de technologies dont nous ne maîtrisons ni la production ni le recyclage. À titre d’exemple, de nombreux projets construisent des « boîtes hermétiques » qui provoquent des problèmes, tels que l’effet de thermos, qu’on tente de corriger ensuite par l’utilisation de la climatisation. Ce processus génère non seulement des émissions de formaldéhyde à l’intérieur des bâtiments, mais également un déséquilibre de l’hygrométrie, provoquant des problèmes de surpression insupportables. La technologie, avec ses capacités de simulation, est un atout précieux. Elle permet de réduire le temps nécessaire à l’exécution de plans nécessaires à la compréhension des projets, à l’avantage du temps de réflexion et de conception. Le principal problème demeure l’inaccessibilité de ces technologies, qui sont souvent trop coûteuses pour les bureaux d’études ou des architectes rémunérés selon les barèmes d’honoraires en vigueur en Tunisie… d’où la nécessité de subventionner la matière grise en priorité.
A. | La construction durable repose souvent sur l’utilisation de matériaux locaux et des techniques innovantes. Quels exemples de projets ou de solutions illustrent cette approche en Tunisie, et comment les généraliser à l’échelle nationale ?
L.R. | Il existe de nombreux exemples de projets ancestraux à travers le pays qui illustrent parfaitement l’intégration de solutions durables. À titre d’exemple, le foyer universitaire de Tozeur, qui utilise des matériaux locaux et des solutions bioclimatiques, démontre qu’il est possible de concilier modernité et durabilité tout en préservant le patrimoine architectural. Pour généraliser cette approche à l’échelle nationale, il serait crucial de promouvoir des projets similaires et de favoriser une meilleure coordination entre les artisans locaux, les architectes et les entreprises de construction, tout en prenant en compte les spécificités du contexte naturel, voire régional. En outre, la mise en place de politiques de financement adaptées et de programmes de formation pour les professionnels du secteur pourrait accélérer l’adoption de ces solutions innovantes.
A. | Quel rôle les acteurs privés et publics doivent-ils jouer pour promouvoir la durabilité dans le secteur ?
L.R. | Tant que les cahiers des charges et les normes continueront de privilégier les méthodes et matériaux de construction loin des principes de durabilité, et tant que les subventions financeront des industries polluantes comme la brique creuse ou l’importation de matériaux « déchets » en provenance de l’Occident, il sera difficile de mettre en place un mécanisme permettant d’améliorer véritablement ce secteur, et donc de promouvoir une approche basée sur le bon sens. Pour encourager un changement significatif, il est essentiel d’adopter des normes mieux adaptées au contexte local. Celles-ci devraient non seulement porter sur l’efficacité énergétique, la gestion des déchets de construction et l’utilisation de matériaux durables, mais aussi, et surtout, prendre en compte le confort thermique réel ainsi que les conditions sanitaires à l’intérieur de nos espaces. Cela passe par une attention particulière à la qualité de l’air que nous respirons, et par la réduction des ambiances confinées et artificiellement conditionnées par des machines. Il est également crucial de limiter les émissions liées aux traitements de surface en privilégiant l’utilisation de matériaux ayant subi le minimum de transformations chimiques ou mécaniques, et donc issus du répertoire écologique. Un partenariat étroit entre ces deux acteurs – public et privé – est essentiel pour garantir une transition réussie vers une construction plus durable et plus respectueuse de l’environnement. L’État et les collectivités locales, quant à eux, doivent créer un cadre réglementaire solide et offrir des incitations financières pour les projets verts. Au lieu de subventionner des industries ou des opérations immobilières à consonances écologiques, on ferait mieux de se focaliser sur l’aval du processus, à savoir la subvention d’outils d’assistance à la conception, d’optimisation des performances d’un bâtiment, de coordination entre les différents intervenants et les mesures pour des retours sur expérience efficaces. Ils doivent également investir dans la mise en place des politiques publiques qui assurent la durabilité dans les infrastructures publiques et les projets d’urbanisme.
A. | Quels sont, selon vous, les projets ou initiatives phares qui pourraient servir de modèle pour un développement durable en Tunisie ? Comment voyez-vous l’évolution de la construction durable dans les 5 à 10 prochaines années ?
LR : Cinq à dix ans constituent une prospective à court terme, ce qui est insuffisant lorsqu’il s’agit de durabilité. Dans ce domaine, il est essentiel d’adopter une vision à moyen ou long terme, voire même de se projeter sur plusieurs décennies, à partir de cinquante ans et au-delà. À l’avenir, l’intégration de technologies innovantes, telles que la modélisation de l’information du bâtiment (BIM), combinée à des politiques de recyclage des matériaux de construction et à une gestion optimisée des ressources, permettra de rendre les constructions à la fois plus intelligentes, plus écologiques et plus économiques. Les perspectives pour la construction durable en Tunisie sont extrêmement prometteuses, à condition que les efforts soient faits en matière de formation, de réglementation et de soutien à la recherche appliquée. L’objectif devrait être de faire de la Tunisie non pas un simple importateur de normes et de labels, mais un véritable exportateur de savoir-faire et d’industrie verte, capable de positionner ses experts et ses innovations à l’international. Je suis convaincu qu’avec une telle initiative, reposant sur une collaboration renforcée entre tous les acteurs du secteur, la Tunisie pourrait devenir un modèle de développement capable de rivaliser à l’échelle avec les leaders du secteur.
A découvrir cette capsule avec Lotfi Rejeb, intitulé : « Le culte dans le détail avec Lotfi Rejeb»

Article paru dans Archibat n°63 – Février 2025, vous pouvez le commander ou vous abonner en ligne : https://archibat.info/shop/